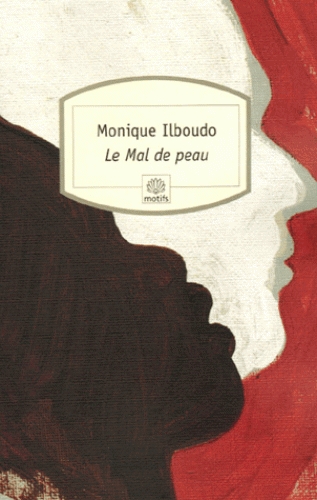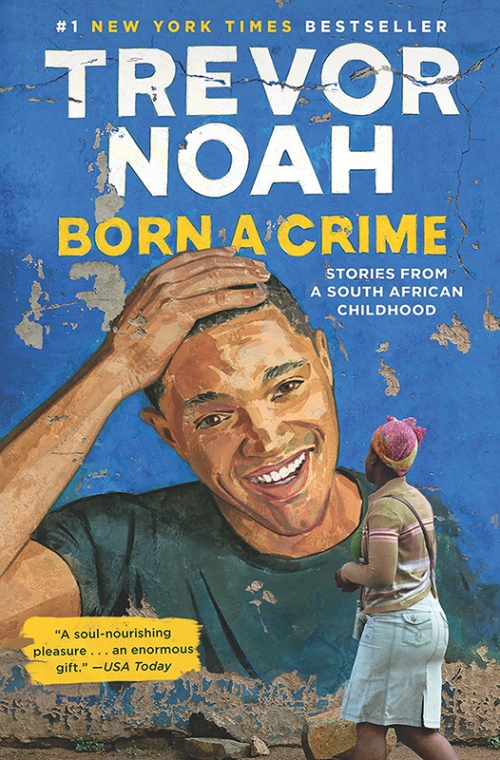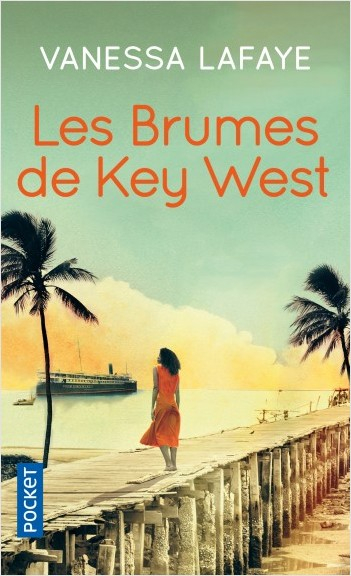« Miniatures » fait escale sur la Route des Indes, en plein océan Indien, dans les Mascareignes, dans l’ancienne Île Bourbon. Le monde entier est passé par là pendant cinq siècles. Tout comme la Guadeloupe ou la Martinique, La Réunion a été le lieu d’un vaste brassage. Témoignant de tous les trafics qui s’y sont pratiqués, sa population es issue de Madagascar (les Malgaches), de l’est de l’Afrique (les Africains), de l’ouest et du sud-est de l’Inde, le Gujarat (les Zarabes) et le Tamil Nadu (les Tamouls) ainsi que du sud de la Chine, notamment de Guangzhou (Canton) et bien sûr d’Europe. Cela fait de cette île un concentré de tout, une planète-terre miniature où l’Europe, l’Asie, le monde arabe et l’Afrique co-existent. Cette position indianocéanique, au carrefour des routes commerciales d’autrefois, en a fait ce qu’elle est aujourd’hui. Insularité, discriminations raciales, famille, maternité, adultère : tels sont les thèmes vitaux abordés dans les six nouvelles de ce recueil. Avec pour toile de fond la nature spectaculaire de cette île : son volcan, ses forêts, ses plaines et plateaux d’altitude, sa flore et sa faune exceptionnels.
La Réunion est une île-monde. Sa littérature est aussi, d’une certaine façon, une littérature-monde.
Mon tour du monde littéraire continue. Aujourd’hui, Cap sur l’île de la Réunion avec ce recueil de nouvelles reçu dans mon swap sur le thé.
Ce recueil de six nouvelles est majoritairement composé de plumes féminines. Commençons par celle qui a été mon coup de cœur tant au niveau de la forme que du fond.
Meurtre dans un jardin – Isabelle Hoarau-Joly
Irma est mariée à Romain, un homme addict à l’alcool. Son mariage tourne au vinaigre, leur amour s’est perdu dans les vapeurs du rhum. Irma se plaint à sa belle-mère mais cette dernière qui a élevé son fils au rang de Dieu rejette l’addiction de son fils sur sa bru.
Irma songe à quitter son mari, mais sans travail et revenu, où irait-elle ?
Sa famille la traiterait d’idiote et refuserait de l’héberger. Combien rêvaient d’un mari fonctionnaire ? Personne ne comprendrait ! Il y avait tant de femmes, dont sa mère qui avait enduré toute une vie un homme qu’elle n’aimait plus, pour qui il ne restait que l’habitude du quotidien: une laisse à laquelle on est attaché ! On s’y accroche par peur de l’inconnu ou du qu’en-dira-t-on !
Irma subit son mariage et s’évade dans son jardin. Son jardin est son paradis, en opposition à l’enfer de la maison. Mais dans ce paradis, un être va mourir.
Une nouvelle alliant français courant et familier. Une nouvelle olfactive et visuelle. On se projette dans le jardin d’ Irma.
Avant le cri, il y a la faute – Jean-François Samlong
« Si le bonheur s’arrête en chemin, se dit-il, le malheur jamais ; il fonce droit sur vous. »
Un fiancé déshonoré par sa promise, un père qui tente d’éviter la survenance du pire, du malheur. Mais je ne suis pas sûre d’avoir compris le fin mot de cette nouvelle.
Le gouffre – Monique Merabet
Le récit a pour cadre spacio-temporel, l’étang-salé, une commune de la Réunion, en 2001. Le narrateur s’appelle Garou. Brebis galeuse, il a été mis au rebut par le reste de sa famille après la mort de sa mère, expatrié dans un orphelinat de la Creuse. C’est un jeune homme que la guigne poursuit. Sympathique histoire avec une chute digne d’une nouvelle.
Le pays paille-en-queue – François Dijoux
La faune, la flore de l’île de la réunion, les villages de l’île de la Réunion sont présentés au lecteur. Ce dernier a même droit à un rappel historique sur l’Îlet-à-Cordes.
Léontine est le personnage principal de cette nouvelle. Elle a conservé la tradition immémoriale des brodeuses venues de Bretagne et son unique motif est la paille-en-queue. Elle évoque sa vie avec Vivian, sa solitude après sa mort et le départ de ses enfants, une fois, adultes.
Madame sans-langue – Monique Séverin
Une nouvelle qui débute par un prologue où une femme demande pardon aux femmes qui ont perdu un enfant. Elle les supplie de pardonner celle qui pleure un fils vivant.
Madame-sans-langue est le personnage central du récit. Une femme à qui l’on a arraché un enfant. Une histoire sur la maternité, la discrimination raciale. Je ne suis pas sûre d’avoir compris tous les contours du récit. J’espère qu’il y aura d’autres avis de lecture sur ce recueil pour découvrir ce qui m’a échappé.
Une sauvageonne chez Molière – Monique Agénor
Une jeune femme se voit refuser un rôle dans un théâtre car elle n’a pas la gueule de l’emploi. Ses cheveux sont frisés, son teint soutenu, son nez inexistant, son accent qui vient de je ne sais où pour reprendre les dires du Directeur.
Une jeune femme qui va prendre sa plus belle revanche. Le lecteur a droit à un rappel historique sur la semaine sanglante.
Nouvelles de la Réunion a été une lecture moyenne dans l’ensemble mais j’ai apprécié ce voyage virtuel de la Réunion. La nature spectaculaire de cette île est très bien décrite.